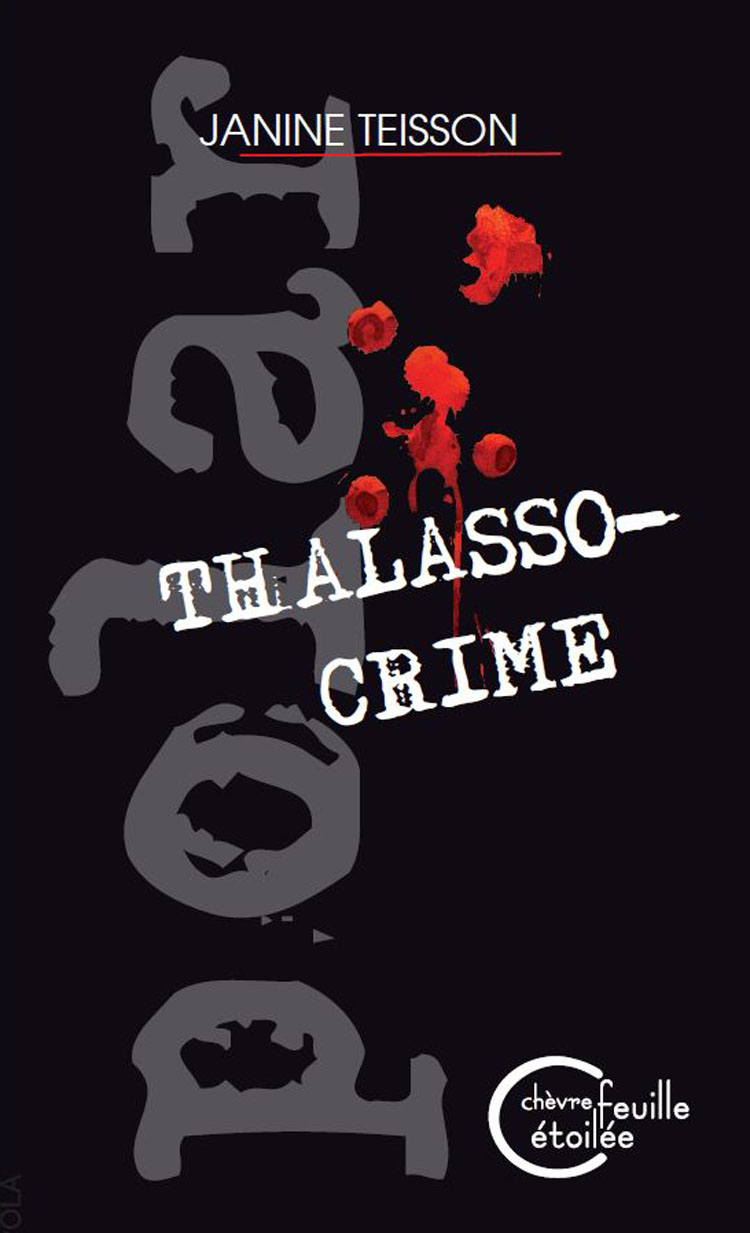page 7
Un crime à l’institut de Thalassothérapie, je vois très bien ça. Ça pourrait se passer ici, dans la baignoire, cabine 7. Ou sous les douches multi-jets, mais la victime serait debout et bien éveillée, et Psychose, ça a déjà été fait et refait en pire. En tout cas, le fait que les filles en blanc installent les clients, appuient sur les boutons puis les laissent mariner seuls douze, vingt ou trente minutes selon la recette, est une sacrée facilité pour l’assassin. Que font-elles pendant ce temps ? Elles préparent la boue d’algues, dans le petit estanco, derrière le comptoir, j’ai vu ça tout à l’heure. Il m’a semblé que l’une d’elle offrait une tisane à une cliente. Je ne sais pas si on doit demander, mais de toute façon, je n’ai pas envie de leur tisane. Toute cette eau me donne tellement envie de pisser ! Quand j’attends sur les sièges en plastique, avec mon maillot de bain glacé sous mon peignoir, je n’ai envie que de fuir.
Je me sens mal, vraiment mal. Quand j’ai ouvert l’enveloppe j’aurais dû tout de suite leur dire qu’ils s’étaient trompés. Leur dire que c’était ma seule semaine entièrement libre depuis l’été et qu’ils me la prenaient pour m’envoyer en thalassothérapie. Ces derniers mois ont été rudes. Enterrer son père, même si c’était un abruti, est rude. J’aspirais à cette semaine de totale solitude. J’ai tellement de choses à écrire, à revoir. Et je suis là, en peignoir, pieds nus, assise sur un fauteuil en plastique blanc, dans un hall carrelé de blanc et j’attends qu’une fille en blouse blanche vienne me chercher. J’ai envie de vomir. J’ai envie de me planter là et de hurler. NOOON !
Je me sens tellement tendue, tellement déplacée ici. Que se passe-t- il ? Une blouse entre deux âges parle d’un ton sévère à une plus jeune près d’une porte en fer qui doit, si mon sens de l’orientation est toujours bon, donner sur la plage. Issue de secours. « Vous savez que cette porte doit être ouverte à partir de neuf heures. C’est vous qui arrivez la première, c’est la première chose que vous devez faire. C’est compris ? » La jeune fille, le visage fermé, baisse la tête et introduit la clé dans la serrure. Dans quelles circonstances pourrait-on avoir besoin d’emprunter cette porte ? Laissons de côté l’incendie bien improbable en ce séjour humide, mais le système de chauffage de l’eau pourrait se dérégler. Tous les curistes jailliraient en peignoir, rubiconds, cloqués, hors de la cocotte minute. Une issue de secours pour les homards.
Je m’attendais à plus de convivialité entre curistes, au moins à des bribes de conversation. Pas du tout. C’est une sorte de supermarché où les clients consomment, sans regarder leurs voisins, des soins qui vont regonfler leur stock d’énergie, de beauté, de jeunesse, que sais-je ? Des soins uniquement aquatiques, physiques et mécaniques. L’âme reste au vestiaire. L’esprit itou. Le sens de l’esthétique, n’en parlons pas. Ces fantômes en peignoirs blancs, les cheveux dégoulinants, sont-ils muets ? Ce n’est pas que j’aie forcément envie de deviser avec ces stakhanovistes de la remise en forme, mais tout de même, comme disait ma grand-mère : « Les chiens se sentent bien le derrière, tu peux dire bonjour à la dame ! »
La jeune fille a rempli la baignoire. J’ai retiré mon maillot de bain. Je me plonge dans l’eau chaude. Elle jette dans le bain quelques giclées de produit odorant. « C’est de l’essence de fleurs. » dit-elle en sortant. Elle ferme la porte coulissante de la cabine. Je suis dans une légère obscurité. La seule lumière qui me parvient à travers les portes en verre dépoli est celle des néons des couloirs. La cabine est étroite, carrelée de blanc du sol au plafond. Les bulles partent du fond de la baignoire et éclosent sous mes chevilles puis sous mes mollets, mes fesses, mon dos, mes épaules. Ça remonte, ça redescend. Chaque fois qu’elles arrivent à mes épaules, je sursaute. J’ai l’impression que quelqu’un me saisit brutalement. Ça déborde. Il y a au moins trois centimètres d’eau sur le sol. Ça bouillonne. Je flotte. Le bruit est incessant. Je suis dans une immense usine à eau. Un bateau inversé. Ça turbine sans cesse. Moi qui suis tellement habituée au silence, qu’est-ce que je fous là-dedans ? Franchement, ce genre d’établissement n’est pas à recommander aux déprimés. C’est un coup à plonger sous les bulles. Quelques gorgées de court bouillon à l’essence de fleurs et adieu Berthe ! On a vingt minutes pour mourir. C’est trop de la moitié !
page 123
Faux nom, faux nom ! Il n’est pas plus faux que l’autre. Que les autres. Vous atterrissez dans votre nom sans avoir rien choisi. Plus tard, si on est femme on prend le nom de son mari, ou de ses maris, bien qu’on n’y soit pas obligée. Quelle coutume barbare de changer le nom de quelqu’un du jour au lendemain, mais quelle vérité implacable aussi ! « A partir d’aujourd’hui, tu ne t’appelles plus Mlle X mais madame Y et tu n’es donc plus toi-même ». Quel est mon vrai nom ? Je n’en ai pas. Je suis innommée. Peut- être bien innommable. C’est bien ma veine, tomber sur un commissaire qui lit des romans policiers, qui sait que j’écris sous un pseudo et que j’ai eu un prix !
Je me suis inventé une sœur jumelle. Depuis que j’ai commencé à écrire. Elle écrit pour la jeunesse avec grand succès et moi j’écris des horreurs, des meurtres sournois, des nouvelles grinçantes, des romans érotiques avec beaucoup de queue et presque pas de tête. J’écris même des poésies désespérées, sous un autre pseudonyme. Tout ça ne se vend pas vraiment, mais ça me fait du bien.
Ma sœur et moi nous avons deux noms différents, évidemment. Elle s’appelle Noëlle Merle, mon nom officiel de femme mariée. Je suis Eva Brodin. Ça m’est venu comme ça, comme le nom de mes personnages. Sans réfléchir. On me demande souvent : comment choisissez-vous le nom des vos personnages ? Je ne choisis rien. Ils arrivent là avec leur nom et je les accepte. Je reçois le courrier de Noëlle Merle à domicile et celui d’Eva Brodin je vais le chercher à la boite postale. Je vis dans les écarts. Je connais très peu de gens au village. En dix-huit ans j’ai écrit vingt-six livres. Avec Pierre nous habitons ici depuis quinze ans et personne ne me connaît. Quelle tranquillité ! Je suis passée à la télévision pour le prix, il y a trois mois, mais avec ma robe en dentelle noire et mon maquillage, même si la postière a regardé l’émission, elle n’a pas pu me reconnaître. D’ailleurs moi-même je ne la reconnais pas la postière, c’est jamais la même ! Je vais aux fêtes du livre de jeunesse sans maquillage, une quelconque barrette en plastique dans les cheveux. Comme aujourd’hui. Je porte mes lunettes à monture rouge, un jean, un col roulé ou une chemise indienne, de bons mocassins, prune ou bleus, (petite touche d’enfance), un anorak ou une veste vietnamienne sur le dos, selon la saison, et voilà, je suis parfaitement fondue dans le peuple touchant et horripilant des auteurs pour la jeunesse. Quand je suis invitée dans un salon de littérature noire, je suis toute différente. La jumelle démoniaque sort ses cheveux à la Louise Brooks, sa longue jupe noire fendue, ses porte-jarretelles, son chemisier transparent sur soutien gorge de dentelle noire, ses escarpins assassins, son rouge à lèvres sanglant, sa poudre de riz et ses bijoux. Aux festivals du Roman Policier, je bois sec, je sors même mon fume-cigarette, je meurtris de bons mots quelques auteurs bien imbibés. Je m’amuse. Mes yeux sont verts sous mes lentilles. Quelle fascination ! Si l’un d’eux me glisse le numéro de sa chambre d’hôtel, je le mets en loterie ou le glisse en silence dans mon soutien-gorge. En laissant un moment mes ongles laqués de rouge Shanghai appuyés sur la blanche peau de mon sein. La plupart du temps je le laisse attendre tandis que je lis un bon polar au lit avec un masque décontractant sur le visage. Plaisir subtil.
C’est après la mort d’Yvan que je me suis vraiment ressentie double. La première année de mouise passée chez mes parents, ils en ont profité pour me dire que je l’avais cherché, que c’était bien fait, qu’ils le savaient, épouser un exalté, un anarchiste, etc… Et après, il y a eu une année dans le garage. Et puis plus d’Yvan. Alors j’ai eu l’impression qu’une autre personne, née de mes cendres avait repris le cours de ma vie. Un être morcelé, couturé, cloisonné. J’ai tout à fait conscience d’être une sorte de monstre. Pas un monstre qui pourrait déborder anarchiquement. Non, un monstre-puzzle à peu près en ordre.
page 247
- Planquez vous. Ne quittez pas des yeux les fenêtres. Le tireur est rapide. Il a utilisé un fusil à pompe.
Le chef règle le mégaphone et crie dedans :
- Monsieur Slimani, nous allons donner l’assaut à votre maison. Nous sommes nombreux. Vous êtes cerné. Mieux vaudrait vous rendre tout de suite pour ne pas aggraver votre cas.
Il s’aplatit aussitôt sur le sol. Un autre projectile vient cette fois-ci frapper le portail en métal avec un bruit de tonnerre. Le trou est énorme, la balle est allée se ficher dans la BMW. Ils entendent le Pssschitttt du pneu qui se dégonfle.
- Ceci est notre dernière sommation. Rendez-vous ou nous ouvrons le feu !
Pas de réponse. Maintenant l’opération est lancée. Le chef, très calme, parle dans son talkie. On entend des tirs à l’arrière de la maison.
- Sûrement pour les occuper par derrière. Ils vont essayer de forcer la porte. Ou les volets entrouverts au rez-de-chaussée, souffle Gris à Céline. Qu’ils fassent gaffe.
Les GIPN tirent encore une fois à l’arrière de la maison. Aucune riposte. On entend les portes des villas voisines s’ouvrir. Des phrases inaudibles fusent. Les voisins protestent. Soudain dans un bruit d’explosion terrible le toit de la maison où se terrent Malik et Abdel Aziz se soulève comme un chapeau en papier. Les volets s’ouvrent violemment, les vitres sont soufflées. On entend le gling gling, gling du verre qui dégringole. Des objets sortent par les fenêtres, dans une poussière blanche, opaque. Les assaillants ont l’impression d’être soulevés du sol comme si l’explosion venait du centre de la terre. Et immédiatement après c’est un silence surnaturel puis des sirènes de sécurité qui hurlent dans le quartier et des cris dans les maisons voisines.
Murey voit, à travers la poussière, la porte d’entrée s’ouvrir.
- Arrêtez !
L’homme couvert de poussière, tient une arme à la hanche. Il court. Un gars du GIPN, placé juste en face de l’entrée, dissimulé par la haie, tire. L’homme trébuche plusieurs fois, lâche son arme et s’affale dans l’allée de graviers.
- Ce n’est pas Malik! crie Murey.
Mais Gris n’entend rien. L’explosion l’a rendu sourd, momentanément. Le chef hurle à présent dans son talkie.
- Restez où vous êtes ! Le tireur a été neutralisé. Patrick, Simon, vous venez. Avec le toubib, couvrez-le. On va dans la maison. Commissaire, appelez le SAMU.
Est-ce que les autres sont devenus sourds là bas ? En tous cas ils ne répondent rien. Ils sont en train de porter l’un des agents du GIPN, projeté à terre par le souffle et qui a perdu connaissance. Céline qui était postée du côté du parking a une blessure à la main qui saigne fort. Un morceau de métal. De loin elle fait signe à Murey et Gris de ne pas s’inquiéter. Ils passent par dessus le pilier effondré et se dirigent vers le corps sanglant que le médecin a retourné sur le dos.
- C’est Abdel Aziz. Il est mort.
Gris, silencieux, la bouche sèche, regarde l’homme à terre. L’homme du GIPN, mince, pâle et très jeune sous son casque, arrive.
- Je suis désolé, j’étais mal placé et il courait courbé, j’aurais voulu l’avoir dans les jambes et puis…
- De toute façon, je crois que ce type n’avait plus rien à perdre.
Les hommes du GIPN sont entrés par la porte ouverte. Arme au poing, précédés du démineur, ils inspectent. A travers une poussière épaisse ils distinguent un couloir, une salle de séjour. L’explosif a dû être placé dans l’escalier. Il n’y a plus d’escalier, seulement un vide qui se prolonge par un trou dans le toit. Comment faire pour monter à l’étage ? Ils ressortent. Soudain, ils entendent appeler.
- Messieurs ! Messieurs !
C’est le voisin de la maison mitoyenne, qui appelle du balcon. Il semble sortir d’un sac de farine.
- Messieurs, j’ai un trou dans le mur de ma chambre! Ca donne dans l’autre maison. Je crois qu’il y a quelqu’un dedans ! Il a l’air blessé ! Venez, j’ai peur !
- Allons- y !
De chez le voisin, qui ne cesse de répéter sur un ton geignard : « Ah, ça pour un premier de l’an, alors, c’est un premier de l’an ! Ah ça ! » ils montent à l’étage et en effet, de grosses coulures de laine de verre pendent du plafond éventré et se déversent sur le dessus de lit rose. La chambre dévastée ouvre directement chez Abdel Aziz.
- Taisez vous !
Dans ce silence plein de choses qui retombent et craquent et volettent qui est celui d’après explosion, ils entendent comme un gémissement. Murey, dans son grand manteau noir en pure laine, qui se couvre de poussière blanche, passe en premier,.
- C’est par là. Attention, le plancher tient à peine. Restez derrière moi. Collez aux murs.
- Oh merde alors !
Il y a un corps sous des gravats, un corps auquel il manque quelque chose et qui saigne abondamment, un corps qui dégage une puanteur suffocante. Bizarrement allongé. Les deux mains liées dans le dos. Dehors on entend la sirène de l’ambulance.
- L’ambulance ! Elle est pour lui ! Vite ! Descendez, allez les accueillir, montrez-leur le chemin.
Gris de la fenêtre du voisin aux vitres brisées, se penche et crie aux gens du SAMU qui sortent de l’ambulance :
- Montez tout de suite par ici. Le blessé est là, il a une jambe coupée !