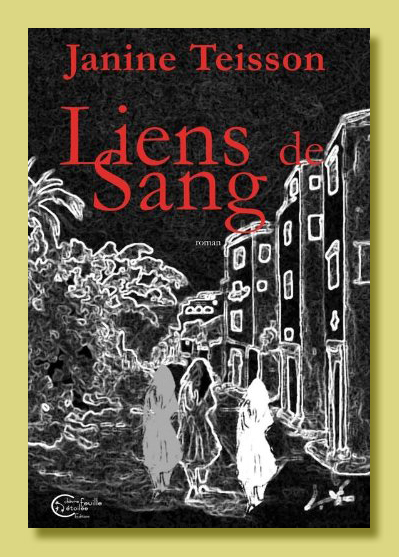Djeymouna
J’entends son pas de vieux, le bruit de sa canne sur le sol. Vam vam pac ! Vam vam pac ! La porte s’ouvre. La flamme de la chandelle dans le bougeoir d’argent se couche. Il entre. Mon mari. Plus vieux que mon père. Je suis assise au milieu du lit. J’ai laissé faire les femmes. Elles m’ont mise en tenue d’épousée. Je n’ai rien dit. Je serrais les dents. Du sang dans la bouche.
Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé avant. Comment est-il arrivé jusqu’à moi ? Un genou déjà sur le lit haut. Et ce geste qu’il a osé pour me pousser à l’épaule et m’allonger tandis que de l’autre main, laissant sa canne, il a voulu soulever mes robes. J’ai appuyé le poignard recourbé de Sid Ahmed sur la gorge du vieux chacal. Il roulait des yeux.
— Je ne serai jamais ta femme, jamais. Je ne veux pas que tu me touches. Tu m’entends ? Si tu essaies encore une seule fois je t’égorge et je m’égorge après. Tu sens le froid sur ta peau ? Tu le sens ?
La peau flasque de son cou était entaillée. Une goutte de son sang immonde est tombée sur mon poignet. Il tremblait comme un cabri nouveau né. L’odeur de sa peur me répugnait.
— Lève-toi ! Sors de ce lit !
Il a glissé du lit. Il n’avait plus rien du fier bachagha des roumis qui crachait sur les paysans. Ah comme j’aurais aimé qu’ils le voient, me suppliant, la voix chevrotante, de faire quelque chose pour qu’il ne soit pas la risée de la maison. Il murmurait entre deux hoquets.
— Elles attendent derrière la porte, elles attendent, tu le sais.
— Fous le camp !
Il a reculé et d’une voix hargneuse :
— Je dirai que tu n’étais pas vierge, je te répudierai. Les roumis auront vos terres, les terres arch et les terres habous aussi. Vous mangerez l’herbe des fossés, toi avec eux si ton père te laisse en vie.
Il s’est adossé au mur. Au moindre de ses mouvements je tendais mon poignard turc. J’ai pris sur le lit le bâton d’olivier qui lui servait de canne. Le pommeau en était renflé, poli. J’ai ouvert le lit. J’ai soulevé mes robes devant lui. Allongée sur le drap blanc, les jambes ouvertes, sous son regard fou, le poignard posé près de ma cuisse, à deux mains, j’ai enfoncé le bâton d’olivier en moi et en une poussée, avec un grand cri, han ! j’ai fait jaillir le sang.
— Voilà, j’ai fait quelque chose pour toi. Sors d’ici !
J’ai jeté le bâton par terre, je me suis enveloppée dans les couvertures. Les mains serrées autour du manche du poignard calé entre mes seins naissants, berçant ma douleur avec les sourates de Sid Ahmed, j’ai cherché le sommeil. Plus tard dans la nuit les femmes sont venues retirer de sous mes fesses le drap taché et j’ai entendu comme dans un rêve leurs you-you.
Claudia
Ismaïl, le sang-mêlé, le bâtard, Djeyhmouna la renégate, je me suis accrochée à vous pour avoir la force de vivre, la force de me lancer et d’avancer malgré le poids qui pesait sur moi, qui pesait sur mes parents, et dont j’ignorais la nature.
Ma mère s’effaçait devant mon père. Lui devenait chaque année plus raide et péremptoire. Si peu respectueux d’elle ! Qu’est-ce qu’on peut faire pour qu’un homme ne s’énerve pas ! Et dans le monde entier, à chaque seconde il y a des femmes qui se taisent, qui courbent l’échine et écartent les jambes pour qu’un homme ne s’énerve pas. J’en devenais enragée. Elle se taisait. Elle filait doux. Je ne comprenais pas. Je pensais : elle trahit notre lignée.
Je pense aux heures passées devant la glace à me dire que j’étais une résurgence de vous, Ismaïl et Djeymouna, un signe, une exigence à travers les âges. La part secrète de mon adolescence a été ce dialogue avec vous, toujours repris, toujours renouvelé, jamais clos. Je vous promettais que je serai digne de vous. Je me promettais de ne pas me laisser abattre, moi. De ne pas me soumettre. Je vivais sous votre regard. Elevée sans dieu, c’est vous que j’avais choisis. Dois-je perdre la foi ? Est-ce si important que vous soyez ou non mes ancêtres ?
Monique
Ah non ! Ne profite pas de tous ces produits qui affaiblissent mon cerveau. As-tu besoin de revenir après toutes ces années ? La guerre dans laquelle ils ont déchiré ton innocence est classée. Personne n’y pense plus. Et puis je la connais par cœur, ta lettre, tu le sais. Ils l’ont chiffonnée, ils l’ont brûlée avec le briquet à essence qui leur sert à enflammer les brindilles qu’ils leur enfoncent sous les ongles. Que croyais-tu qu’ils en feraient ? Franchement ? Qu’ils l’enverraient en France ? Ton corps, oui, ils l’ont renvoyé en France : « Mort courageusement au combat ». Je comprends que tu n’aies pas la paix, mais laisse-moi. Je ne suis pas ta mère ! Je ne sais pas qui est ta mère. Tu viens dans ma tête parce que je suis sans défense. Parce que tu peux t’installer dans le nid intact de ma douleur et de mon dégoût. Le soldat inconnu, c’est toi. Alors pourquoi faut-il que je voie tes yeux d’enfant, et surtout ce qu’il y a dedans ? Bon d’accord, lis moi ta lettre et puis tu partiras ?
Maman,
Je ne reviendrai pas d’Algérie. Ce n’est pas une guerre qu’ils nous font faire ici. Ils nous transforment en monstres. Ce dimanche, il faisait très chaud. A huit heures du matin quatre de mes « camarades » ont sorti un homme de la salle où croupissent vingt-deux « suspects ». Suspects parce qu’Arabes. Depuis quinze jours, je te l’ai dit, nous n’avons plus le droit de sortir. Par désœuvrement ils se sont amusés à torturer ce jeune homme. Il est vingt heures. Ses râles d’agonie, si forts que je me bouchais les oreilles, ont cessé. Ils ont tout utilisé. La magnéto, les cheveux brûlés à l’essence, ils lui ont fait avaler du ciment liquide, ils ont mis du sel et du poivre et des graviers dans les plaies qu’ils ont ouvertes sur tout son corps avec un opinel. Tu te souviens de l’opinel que Grand-père m’a donné avant mon départ ? Ils l’ont rempli d’eau avec un tuyau d’arrosage. Par la bouche, par le nez, par l’anus. Et tout cela sans jamais cesser de l’insulter et de le rouer de coups de pieds. J’ai engagé une balle dans mon pistolet et j’ai pensé je vais courir là-bas et achever ce malheureux. Je ne l’ai pas fait. Je n’ai jamais tué personne. J’ai seulement pleuré et mordu ma main. Je pensais aussi que si je le faisais, ils s’en prendraient sûrement à un autre suspect. Il y a une fosse pleine de corps en charpie derrière les bâtiments. Ils l’ont comblée au bulldozer avant-hier.
Maintenant je vais nettoyer mon arme. Je suis toujours aussi maladroit. Je n’ai pas changé, tu sais.